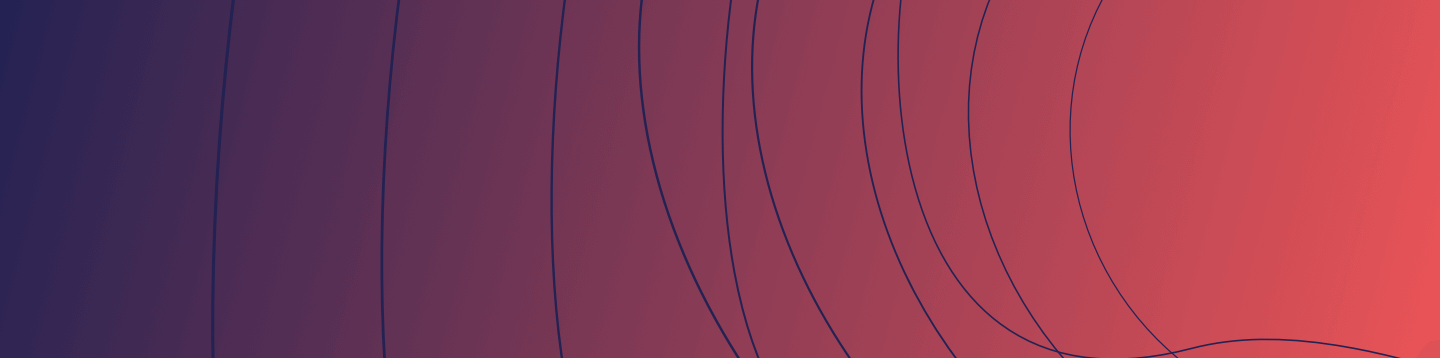Avec l'essor de l'Internet des objets, socle de la révolution de la smart city, la régulation est amenée à évoluer dans les télécommunications. Garant de la concurrence du secteur, Sébastien Soriano, le patron de l'Arcep, met un point d'honneur à ce que " le jeu reste ouvert " entre les anciens et les nouveaux acteurs.
L'Internet des objets va constituer un tournant dans le monde des télécommunications. Face à cela, vous jugez que le rôle de l'Arcep, gardienne de la concurrence dans les télécoms traditionnelles, doit évoluer. Elle doit, d'après vous, se muer en "régulateur de la connectivité". Pourquoi ?
Parce que nous nous intéressons à toutes les formes de réseaux. Lors de l'ouverture à la concurrence des télécoms en 1997, on pensait beaucoup au réseau téléphonique fixe, un petit peu au mobile, et pas du tout à l'internet. Depuis, le mobile a pris une importance considérable, et surtout Internet s'est imposé. D'ailleurs, saviez-vous que le mot " Internet " ne figurait pas dans la loi de libéralisation des télécoms de 1996 ?... nous travaillons donc sur ces nouveaux réseaux du mobile et de l'Internet, notamment à travers la neutralité du Net. En parallèle, dans une démarche prospective, nous nous intéressons aux réseaux de demain, c'est-à-dire aux réseaux de l'Internet des objets, que nous percevons à l'avenir comme un objet de régulation.
Cela étant, nous ne sommes pas des empêcheurs de tourner en rond : réguler ne veut pas forcément dire embêter son monde ! Mais on voit bien que les réseaux de l'Internet des objets vont être des réseaux innovants, des réseaux mondiaux. En conséquence, la manière d'agir du régulateur sur ces réseaux va évidemment être très différente de la régulation très lourde qu'on a connue sur les réseaux télécoms classiques.
L'Internet des objets est au cœur des smart city, qui reposent sur ces technologies de communication nouvelles pour améliorer les services urbains ou en réduire les coûts. Comment l'Arcep accompagne-t-elle cette transformation ?
Dans la smart city, il y a deux couches : d'abord une couche de connectivité, puis une couche d'intelligence. Très clairement, notre travail concerne la première. Il s'agit de savoir comment les collectivités locales vont être en capacité d'assurer une connectivité très forte des transports, de l'espace urbain, de l'habitat, etc… C'est là-dessus que nous nous concentrons. Ce que nous souhaitons, c'est que la régulation garantisse un jeu ouvert entre tous les types d'acteurs. Car il y a un risque que l'écosystème le mieux constitué, le plus fort - puisqu'il existe depuis plus de 20 ans -, celui du mobile, tente de préempter l'Internet des objets, qu'il veuille imposer ses standards, ses normes et ses technologies. Nous, ce que nous voulons, c'est que le jeu soit ouvert, en particulier aux acteurs utilisant d'autres technologies. Parmi elles, il y a les technologies LPWAN [pour Low Power Wide Area Networks, caractérisées par une basse consommation, une très longue portée, et un coût très faible, Ndlr], avec des acteurs comme Sigfox ou l'alliance LoRa.
Nous serons donc vigilants, notamment à l'international. Dans tous les travaux auxquels nous participerons ou que nous initierons, nous ferons attention à ce que le jeu reste bien ouvert, afin que chacun puisse participer, et que les meilleurs s'imposent sur la base de leurs mérites.
Par ailleurs, nous aurons un rôle plus direct en matière de ressources.
C'est-à-dire ?
Pour faire marcher des réseaux, il faut des fréquences et des numéros.
En matière de fréquences, nous avons lancé en 2014 une revue de notre patrimoine de fréquences, celles sur lesquelles nous sommes compétents. C'est un gros chantier, parce qu'il porte sur de nombreuses bandes de fréquences. La première conséquence de ce travail a été l'allocation de la bande des 700 MHz aux opérateurs mobiles l'année dernière. Maintenant nous allons nous intéresser aux autres bandes. Et là, je suis totalement agnostique, et je ne pars pas du principe que toutes les fréquences doivent être réservées aux opérateurs mobiles.
En clair, si nous constatons que d'autres acteurs sont intéressés par des fréquences pour l'Internet des objets, nous n'hésiterons pas - dans le respect des normes internationales, bien sûr - à leur ouvrir le jeu, pour que l'accès à ces ressources essentielles soit aussi large que possible.
Ensuite il y a la question des numéros. Pour l'écosystème mobile, il est évident que l'Internet des objets signifie demain de donner un numéro de téléphone à chaque objet. Nous avons donc ouvert pour les objets des numéros de téléphone à 14 chiffres, plus longs et donc plus nombreux. Mais on peut aussi imaginer d'utiliser des adresses IP. Or aujourd'hui il y a une pénurie d'adresses IP dans la version actuelle d'Internet, l'IPv4 [pour Internet Protocol version 4]. Si l'on veut utiliser l'IP comme système d'adressage de l'Internet des objets, il va falloir travailler sur l'IPv6. Nous allons donc passer en revue tous les moyens à notre disposition pour accélérer la mise en place de l'IPv6 en France. Axelle Lemaire vient d'ailleurs de saisir officiellement l'Arcep sur ce dossier.
Reste que toutes ces nouvelles normes se définiront plutôt au niveau européen, voire mondial ?
Effectivement, beaucoup de choses se décideront à l'échelle européenne et internationale. Il n'empêche qu'en Europe, plusieurs régulateurs ouvrent déjà le jeu, notamment au niveau des fréquences. Ainsi, il y a eu une consultation de l'Ofcom, le régulateur britannique, pour ouvrir des bandes de fréquences très basses (entre 10 et 100 MHz) à l'Internet des objets. C'est intéressant, on regarde… Vous savez, même si les choses se jouent à l'échelle internationale, il arrive un moment où les organismes de normalisation prennent en compte les situations de marché. Si certaines technologies se développent et sont adoptées dans plusieurs pays, il est difficile pour eux d'imposer après coup une norme différente… Par ailleurs, à travers notre investissement renforcé dans le Berec [l'Organes des régulateurs européens des télécoms, dont Sébastien Soriano a pris la vice-présidence cette année, en attendant d'en prendre la présidence en 2017], nous ferons entendre notre voix dans les différents organismes de normalisation.
Plutôt que de parler de smart city, vous préférez la notion de "territoires intelligents". Pourquoi cette dénomination? Craignez-vous une nouvelle "fracture numérique" entre les villes - mieux placées pour attirer les grands groupes ou les startups innovantes - et les territoires ruraux?
Nous avons choisi de parler de " territoires intelligents " car, à notre sens, le risque relève plus d'un déphasage que d'une fracture. Nous pensons en effet que dans la smart city, il y a moins de difficultés d'aménagement du territoire qu'avec les réseaux classiques. Parce que les coûts de déploiement des réseaux ne sont pas les mêmes. Ainsi, par exemple, pour bâtir un réseau national de type Sigfox ou Lora, il faut quelques milliers d'antennes pour couvrir toute la France, c'est à dire peut-être cinq fois moins que pour un réseau mobile, et, qui plus est, ce sont des antennes plus simples. En clair, faire de l'aménagement du territoire en Internet des objets ne représente pas a priori un coût faramineux. Pour le volet connectivité, nous pensons donc que le risque de fracture numérique est faible.
En revanche, il y a des risques en termes de services et de gouvernance. Les grandes métropoles ont, grâce à leurs importants services publics par exemple, la capacité de générer énormément de données. Elles sont donc en mesure d'attirer facilement des grands groupes [comme IBM ou Orange] pour se transformer en smart city. Ceux-ci sont à l'évidence moins enclins à investir dans un "smart village", où il y a moins de données, moins de trafic, moins de population… A mes yeux, le risque de fracture numérique se situe donc plutôt au niveau de l'exploitation des données.
Comment éviter cela ?
Dans notre dernier colloque avec les collectivités territoriales et les opérateurs, la possibilité d'un service public de la donnée décentralisé a été évoquée. Dans la loi numérique d'Axelle Lemaire, il y a également cette idée d'un service public de la donnée. C'est d'ailleurs une petite révolution, parce que cela signifie qu'on réfléchit désormais à une politique de l'Etat pour la donnée. Or les représentants des collectivités locales nous ont dit qu'ils voulaient, eux aussi, en faire partie.
Outre un service public national, il pourrait y avoir des services publics locaux de la donnée. Tout l'enjeu serait ensuite que les territoires, par exemple les métropoles et les régions, arrivent à créer une dynamique d'action commune pour que personne ne soit lésé. Ceci permettrait d'éviter qu'une ville lance seule son service public de la donnée avec des acteurs privés, laissant de côté les territoires péri-urbains et ruraux.
Faut-il un plan smart city, à l'intar du plan France Très haut débit, pour s'assurer que tous les territoires bénéficient de ces nouveaux services numériques ?
Je pense qu'il faut amorcer la réflexion sur les territoires numériques de demain. En tant que régulateur, l'Arcep veut pour l'instant servir d'incubateur à ce débat, en prenant en compte les attentes des collectivités au sens large. Peut-être que, dans quelques années - lors du prochain quinquennat ? -, le gouvernement jugera qu'il y a besoin d'un accompagnement national. Celui-ci pourrait être la prolongation du plan France très haut débit [qui repose essentiellement sur le déploiement de la fibre dans tout l'Hexagone d'ici à 2022]. Sur cette couche d'infrastructures, on pourrait peut-être imaginer un plan d'accompagnement national pour façonner un service public de la donnée.
Propos recueillis par Pierre Manière