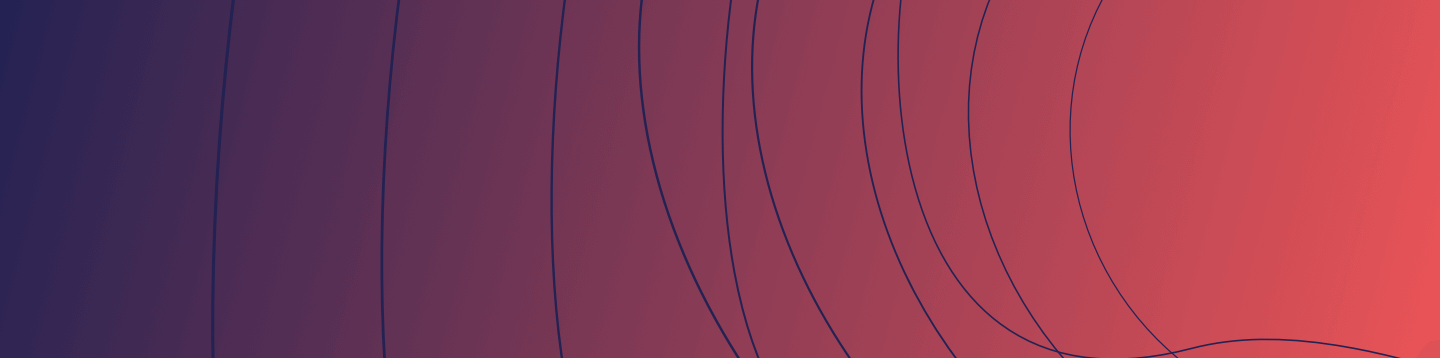" Mesdames et messieurs les parlementaires,
Mesdames et messieurs les intervenants,
Mesdames et messieurs,
Je suis très heureuse d’introduire les travaux de ce Giverny du Numérique, sur les enjeux de souveraineté et d’impact environnemental du numérique, tout en convoquant parmi les thèmes abordés la responsabilité numérique des entreprises.
Nous sommes au cœur des sujets que porte le cercle du Giverny : la responsabilité sociale et environnementale des entreprises notamment, face aux transformations technologiques de notre société.
Ce sont aussi des sujets qui sont au cœur de la nouvelle stratégie de l’Arcep présentée en janvier dernier que ce soit les enjeux environnementaux du numérique ou les enjeux de souveraineté que l’Arcep cherche à promouvoir notamment via les travaux en cours sur la régulation du marché des services cloud et de la data, afin de les rendre plus concurrentiels, plus ouverts, afin de faciliter le changement de fournisseurs, ou le partage de la donnée, permettant ainsi à des offres souveraines de se développer. Je vais revenir sur ces deux enjeux.
D’ abord sur les sujets environnementaux :
Alors c’est vrai : vous me direz en premier : le numérique est source d’innovations et donc apporte autant de solutions nouvelles pour la transition écologique. Par exemple les thermostats connectés, les capteurs de détection de fuites d’eau, l’analyse de données pour optimiser la consommation de ressources et la maintenance préventive dans les usines, la gestion intelligente des bâtiments et de l’énergie… ce sont de bons exemples, et il faut bien sûr s’appuyer sur le numérique pour la transition écologique mais…
Mais : le numérique, c’est déjà 10% de la consommation d’électricité en France, une empreinte carbone qui pourrait tripler d’ici à 2050, 70 millions d’équipements (smartphones, téléviseurs) inutilisés ni réparés ni recyclés en France… Les chiffres que nous publions depuis 2020 sont sans appels :les impacts environnementaux du numérique se révèlent de plus en plus importants, toujours plus importants notamment avec la banalisation de l’usage des intelligences artificielles génératives à la place d’une simple requête Google. La petite musique « le numérique est la solution » commence à sonner un peu faux ou plutôt devrais-je dire, le piano sur lequel elle est jouée doit être réaccordé.
C’est la première alerte que je souhaite aborder avec vous : la forte croissance des impacts du numérique n’est pas compatible avec les engagements pris par la France et l’Union européenne à travers l’Accord de Paris. Aujourd’hui, le numérique, si indispensable à notre économie, si essentiel à notre quotidien, semble insoutenable.
La première action est de mieux comprendre pour mieux agir.
L’Arcep a initié des travaux en ce sens, en collectant des données environnementales auprès des acteurs du numérique. Chaque année, nous analysons et restituons ces informations, afin d’inciter les acteurs du numérique à de meilleures pratiques et afin d’éclairer le choix des consommateurs, pour orienter le marché dans une meilleure direction.
Utiliser un réseau fixe consomme deux fois moins d’énergie qu’un réseau mobile, passer à la fibre plutôt que garder son abonnement ADSL, c’est 4 fois moins d’énergie, garder son téléviseur ou son smartphone, c’est bon pour le porte-monnaie, mais c’est aussi très bon pour la planète. Ce sont bien sûr des actions utiles.
Mais ces travaux nous ont aussi permis de mettre en lumière l’interdépendance de tous les maillons de la chaîne du numérique : terminaux (smartphones, téléviseurs…), réseaux télécoms, centres de données avec tous les services numériques que nous utilisons.
Ces services numériques sont souvent les grands oubliés des réflexions environnementales des politiques publiques ou économiques, car ils sont « invisibles », semblant ainsi ne pas avoir d’impact…
En réalité, écoconcevoir les services numériques est devenu indispensable. C’est un peu traiter le problème à la source.
De quoi s’agit-il ? Cela consiste d’abord à ce que les développeurs et éditeurs rendent leurs services plus efficaces, pour qu’ils consomment moins de ressources de l’équipement de l’utilisateur, des centres de données, ou de bande passante du réseau, pour un niveau de service équivalent.
Cela consiste aussi à la remise en cause de certaines fonctionnalités introduites dans les services numériques, notamment les réseaux sociaux comme l’autoplay ou le défilement infini.
Ces fonctionnalités sont au cœur du modèle d’affaires des grands fournisseurs de contenus. Elles sont conçues pour que nous passions toujours plus de temps en ligne. Ne sont-elles pas à bannir ? Dans ce cas, écoconcevoir les services numériques contribueraient non seulement à la protection de l’environnement mais aussi à une certaine responsabilité sociale des entreprises du numérique dans la lutte contre l’addiction aux écrans, qui est un enjeu de santé publique majeur, très difficile à appréhender.
La diffusion rapide des intelligences artificielles génératives fait prendre conscience que les services numériques ont un impact. Ces services consomment déjà une part croissante de l’électricité nécessaire au fonctionnement des datacenters… Ne les laissons pas devenir des ogres de notre électricité, aux dépends d’autres usages et du climat. Nous avons toutes les compétences en France et en Europe pour concevoir des IA performantes et sobres, qui permettront aux entreprises de concilier compétitivité, souveraineté et respect des objectifs de l’Accord de Paris. Ces IA françaises ou européennes, plus responsables et plus transparentes, bénéficieraient alors d’un avantage concurrentiel face aux Big Techs et à leur gigantisme.
Face aux grandes plateformes numériques, principaux fournisseurs des services numériques que nous utilisons, le bon niveau d’action est l’Europe et la France doit en être l’aiguillon.
C’est d’ailleurs ce que nous avons entrepris sur la régulation des services Cloud. Plus d’un an avant l’entrée en vigueur du Data Act, l’Arcep s’est vu confier la mission de réguler ce marché. Cela nous a permis de rencontrer les acteurs, les utilisateurs, toutes les parties prenantes et de faire un travail approfondi pour bien comprendre les possibilités de normalisation ou les règles à mettre en place pour déverrouiller le marché du Cloud, afin de faciliter les changements de fournisseur.
Nous sommes convaincus que c’est sur un marché plus ouvert, plus concurrentiel, où les freins au changement de fournisseurs sont levés que les offres alternatives et souveraines peuvent se développer. C’est tout le sens de notre travail et de notre ambition.
Cette expertise développée depuis un an, nous la portons au niveau européen et échangeons avec la commission européenne pour leur faciliter la mise en œuvre rapide du Data Act à compter de son entrée en vigueur en septembre 2025.
En conclusion, je veux partager ce que j’ai dit lors de la présentation de la stratégie en début de cette année.
L’Arcep contribuera, par sa régulation et par son action en Europe et au niveau international, à créer les conditions d’un numérique désirable, au service de l’émancipation des individus, de la compétitivité de nos entreprises et de la société dans son ensemble. En quelque mots, un numérique désirable c’est un numérique
- Qui n’enferme pas dans des écosystèmes fermés les individus ou les entreprises,
- Qui ne limite pas les développeurs dans leurs plateformes de travail, dans l’accès à leurs clients, mais leur permet de faire profiter leurs innovations à tous,
- Et qui n’épuise pas jour après jour les ressources de notre planète mais les préserve.
Je vous remercie."
Laure de La Raudière.