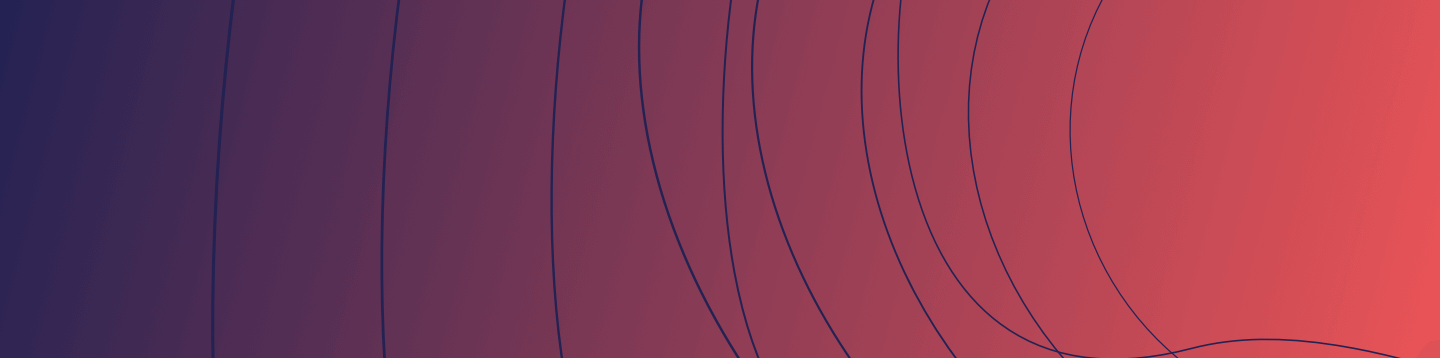Seul le prononcé fait foi
"Merci Monsieur le Président, Cher Patrick,
Madame la Ministre, Chère Anne,
Mesdames et messieurs les parlementaires,
Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs les représentants des collectivités et des opérateurs,
Mesdames et messieurs,
Nous voilà fin 2025. Nous sommes dans une période particulière qui est une période de promesse, une période de transition, et une période de projection.
La promesse, c’est celle bien sûr du très haut débit pour tous et plus particulièrement celle de la généralisation de la fibre optique.
Et nous y sommes presque.
Au troisième trimestre 2025, la couverture en fibre optique de l’ensemble du territoire national va atteindre près de 94 % de locaux rendus raccordables. C’est indéniablement un succès.
Un succès dû à l’efficacité d’investissements considérables, déployés au service de l’aménagement numérique du pays. Un succès dû à un effort collectif : celui des opérateurs, des pouvoirs publics, en premier lieu, des collectivités territoriales. Un succès dû aussi à un cadre de régulation solide, qui a su offrir et continue d’offrir visibilité et prévisibilité à l’ensemble des acteurs. Vous en êtes les premiers artisans, et vous pouvez en être fiers.
Le modèle français suscite désormais un intérêt croissant chez nos partenaires européens. Il doit être préservé.
Maintenant, soyons aussi lucides : ce succès est à consolider. Nous entrons dans la phase la plus exigeante, celle de la finalisation des déploiements, mais aussi celle de la généralisation des raccordements de qualité sur tous les réseaux et celle de la pérennité financière du plan France Très Haut débit.
Ne rien relâcher est sans doute le message que je souhaite adresser à vous tous, aujourd’hui
L’Arcep en tous cas ne lâchera rien. Sur la complétude évidemment, Nous nous assurerons du respect des mises en demeure qui ont été adressées. Et nous veillerons aussi à la réalisation des raccordements complexes en domaine public, indispensables pour le passage du raccordable au raccordé.
Ces exigences n’empêchent pas le pragmatisme : en particulier, le mécanisme dit de « raccordable à la demande » peut être mis en œuvre pour éviter de construire des prises qui ne répondraient pas à une demande actuelle, mais ce dispositif doit fonctionner réellement. Les diverses remontées que nous avons, montrent que ce n’est pas le cas en zone RIP notamment.
L’Arcep sera très attentive à ce qu’un vrai parcours client soit mis en œuvre par les opérateurs au bénéfice des utilisateurs désireux de passer commande. Si ce n’est pas le cas, vous comprendrez tous ici que le local ne pourra être considéré comme RAD au titre de la complétude.
L’Arcep ne lâchera rien. Sur la qualité de service évidemment.
Même si nous constatons une amélioration générale des indicateurs de qualité sur les réseaux accidentogènes, il existe toujours des difficultés sur certains réseaux et des pratiques des agents d’intervention qui sont inacceptables. Il va de soi que nous poursuivons les travaux en faveur de l’amélioration de la qualité des réseaux en fibre optique.
Avec deux membres du collège de l’Arcep, Marie-Christine Servant, Zacharia Alayane, et des services de l’Arcep, je suis allée lundi dernier à Cormeilles en Parisis, dans le Val d’Oise. Cette réunion a montré qu’il reste encore du chemin à parcourir pour mettre fin au jeu de ping-pong persistant entre OI et OC et pour assurer un mode STOC de qualité. Il faut en particulier que tous les acteurs de la filière mettent enfin en place un processus d’escalade dans les échanges, pour les cas de clients non résolus par le mode industriel de production ou de réparation.
Devant les maires de la communauté d’agglomération du Val Parisis et devant les opérateurs, j’ai rappelé aux OC leur devoir de mieux contrôler leurs sous-traitants mais j’ai aussi rappelé à l’OI qu’il avait la possibilité d’exclure un opérateur de son réseau et de passer en mode OI. Je sais que cela peut paraître théorique, enfin c’est théorique jusqu’à ce qu’un OI le fasse vraiment. Et sur les réseaux déjà bien remplis, un OI peut avoir intérêt à le faire, si, malgré les investissements de reprise faits, les pratiques des OC ne changent pas.
Par ailleurs, sur cet enjeu de qualité, je tiens à vous informer que l’Autorité a mis en demeure la semaine dernière, Réseau optique de France, filiale du groupe Iliad, de remédier aux difficultés opérationnelles persistantes sur ses réseaux et au retard significatif constaté dans la mise en œuvre de son plan de reprise des infrastructures reposant sur des points de mutualisation grande capacité.
La période de transition, c’est le passage à l’industrialisation du plan de fermeture du réseau cuivre d’Orange. C’est le plan d’Orange, mais tout le secteur est concerné. Et l’Arcep a imposé des règles claires, au bénéfice de la protection des utilisateurs et de la concurrence.
Le réseau cuivre a été fermé techniquement pour le premier lot de communes en janvier dernier et cela s’est bien déroulé, sans aucune réclamation. Bravo ! En janvier prochain, vous le savez, est planifiée la fermeture technique du deuxième lot ainsi qu’une fermeture commerciale sur la majorité des communes de France.
Orange a procédé à des ajustements de calendrier de la fermeture commerciale, rendus nécessaires à la lumière notamment des prévisions de déploiements des opérateurs d’infrastructure recueillies par l’Arcep, dans son exercice de relevé géographique.
Le plan s’adapte à la réalité du terrain.
A date, 65 communes du lot 2, soit un peu moins de 10 % des communes ont vu leur fermeture commerciale reportée d’un an de janvier 2025 à janvier 2026 ; et 3.052 communes, soit 9 % des communes - représentant environ 70% des locaux - voient leur fermeture commerciale reportée d’un an au titre de la fermeture commerciale massive qui interviendra au mois de janvier prochain. Ces reports sont fortement portés par les zones très denses.
De nouveaux reports ne sont pas exclus, en considération du respect des critères de complétude des réseaux et de disponibilité des offres, afin que cette transition se fasse sereinement pour tous.
La communication sur la fermeture du réseau cuivre est aussi primordiale. Je veux ici saluer les initiatives prises par Infranum et par la FFT, pour sensibiliser les clients au besoin de migrer leurs accès cuivre vers les technologies adaptées. Je veux aussi saluer l’action des syndicats d’aménagements numériques qui apportent au quotidien l’appui aux élus et aux citoyens sur ce sujet, et enfin remercier l’engagement des maires des premiers lots de fermeture du réseau cuivre, qui sont des relais très importants pour la communication et qui accompagnent les personnes les plus fragiles de leur commune, notamment via les CCAS. C’est cet engagement collectif dans la durée qui permettra d’assurer un bon déroulement du projet.
La transition, c’est aussi l’entrée en phase d’exploitation opérationnelle des réseaux FttH. Et avec elle, des interrogations fortes sur la capacité à couvrir l’engagement financier important des collectivités et des opérateurs pour le déploiement du réseau et pour son exploitation.
L’Arcep est pleinement consciente de l’importance majeure, presque vitale, de ces problématiques pour bon nombre de réseaux d’initiative publique.
Vous le savez, nous avons initié des travaux sur ce sujet avec nos outils, ceux de la régulation. Nos outils de régulation à eux seuls ne pourront pas couvrir l’ensemble des difficultés financières rencontrées par les RIP, qui sont de nature diverse : sous-estimation du besoin de subvention, coûts unitaires des travaux plus chers que prévus, souscription aux abonnements fibre plus lente que prévue, sous-estimation des coûts de création de génie civil dans les Business Plan, coûts d’exploitation plus chers… Comme je l’ai dit au Trip de Printemps, nos travaux visent à trouver les bons inducteurs des coûts de la maintenance en conditions opérationnelles des réseaux. Un travail complémentaire, sans doute d’initiative politique, semble nécessaire pour instruire et documenter plus précisément, les difficultés financières des RIP liées au déploiement des réseaux.
A l’été, nous avons lancé une consultation publique pour objectiver l’ensemble des coûts d’exploitation.
Nous avons reçu 42 contributions des opérateurs et des collectivités concernées. Je vous remercie tous, c’est très utile.
C’est un travail complexe, nous assumons de le faire avec rigueur, et donc avec le temps nécessaire à l’expertise d’un tel sujet. Comme vous imaginez, les positions des uns et des autres ne sont pas alignées. Notre objectif est toujours - et j’espère que nous y arriverons - de publier d’ici la fin de l’année une modélisation des coûts qui aura vocation à servir de référence dans le cadre des négociations entre les opérateurs et qui renforcera la lisibilité et la prévisibilité du cadre tarifaire.
Maintenant, la projection. La finalisation de ces chantiers ne doit pas occulter le besoin d’en ouvrir de nouveaux, structurants pour les années à venir.
L’évolution rapide des technologies et des habitudes des utilisateurs impose d’évaluer les perspectives du marché de l’accès à internet. J’en veux pour preuve de fonctionnalités mobiles en direct-to-device reposant sur des infrastructures satellitaires.
Tout comme l’accès fixe par satellite, ces mutations concernant le mobile apportent de nouvelles perspectives pour les zones les plus rurales, non encore couvertes. Mais elles posent aussi de nouvelles questions sur l’évolution du marché.
L’Arcep mène actuellementune consultation publique pour préparer les futures attributions de fréquences mobiles, ouverte jusqu’au 15 décembre prochain et à laquelle je vous invite à participer.
L’ensemble des autorisations d’utilisation de fréquences attribuées aux opérateurs mobiles dans l’Hexagone arriveront à échéance entre 2030 et 2035. La réattribution de ces fréquences porte des enjeux stratégiques, en particulier en matière d’investissements dans les réseaux, de concurrence, d’aménagement numérique ou d’innovation.
L’évolution des usages rend cette projection tout autant nécessaire.
Selon le dernier baromètre du numérique, 9 % de la population utilise uniquement les réseaux mobiles pour se connecter à internet à domicile. 19 % des 18-24 ans et 15% des 25-39 ans utilisent exclusivement une connexion mobile, et cela progresse chaque année. Certains opérateurs ont d’ailleurs lancé une offre d’accès à Internet « oneplay » à prix attractifs pour essayer de capter cette cible de clients potentiels.
L’Arcep va travailler sur ces évolutions de marché dans ses travaux de l’année 2026. Elle est par ailleurs engagée avec son comité scientifique dans une démarche prospective intitulée « réseaux du futur » autour des enjeux de demain.
La virtualisation des réseaux, la résilience, l’IA et les réseaux ou encore choisir son numérique à la lumière des usages ont fait l’objet de notes de synthèse publiées par l’Autorité.
Les données des objets connectés au service des territoires ; l’informatique quantique et les réseaux ; l’avenir de la connectivité mobile feront l’objet de notes de synthèse en 2026. Ce travail et ces notes alimentent nos réflexions bien sûr, mais elles sont faites aussi pour contribuer au débat public sur ces enjeux prospectifs.
L’avenir, c’est également la soutenabilité du numérique, et je connais l’engagement du président de l’Avicca sur ce sujet, rapporteur de la loi qui a confié à l’Arcep le pouvoir de collecter les données environnementales de l’ensemble des acteurs du numériques..
Nous restituons ces informations, dans une publication annuelle intitulée « Pour un numérique soutenable » dont la quatrième édition, en 2025, intègre les résultats des opérateurs, des fabricants de terminaux, des data center, des équipementiers des réseaux mobiles. La prochaine édition sera complétée par les données collectées auprès des fournisseurs de services de cloud afin d’apprécier l’impact environnemental de l’IA.
La projection, c’est aussi réfléchir à la façon dont les IA changent nos pratiques numériques.
Un nouveau défi apparaît aujourd’hui avec l’essor des IA génératives. Nous les utilisons tous maintenant régulièrement en lieu et place d’un moteur de recherche. Elles deviennent des portes d’entrée de plus en plus privilégiées pour accéder aux contenus et services en ligne.
Les IA génératives sont une innovation majeure, avec des bénéfices certains. Nous en faisons l’expérience tous les jours ! Mais les services d’IA générative proposent une synthèse, parfois sans préciser les sources utilisées. Cette réponse « unique » est conditionnée par les paramètres du modèle sous-jacent et les données sur lesquelles il a été entraîné. Ce changement peut freiner la capacité, la liberté qu’a un utilisateur d’accéder à tous les contenus sur Internet ou peut rendre invisibles certains contenus, bridant ainsi l’innovation, ou la liberté d’expression. Ce changement pourrait donc remettre en cause les principes d’un internet ouvert.
C’est pourquoi, dans la continuité de nos missions sur la préservation d’un internet ouvert, nous avons engagé une évaluation de l’impact des IA génératives sur l’ouverture de l’internet.
Nous y travaillerons avec nos partenaires européens.
Tous ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle stratégie de l’Arcep présentée en début d’année qui vise à doter le pays des infrastructures numériques pour les décennies à venir, et de s’assurer qu’Internet reste un espace de libertés.
Enfin, permettez-moi en conclusion d’évoquer avec vous un sujet que je n’ai jamais mentionné devant vous, une cause qui me tient à cœur. Une cause qui fait l’objet d’un consensus fort et qui pourtant peine encore à se traduire dans les faits. Je veux parler de la place des femmes dans le numérique.
Vous avez – et c’est une belle idée, je vous en remercie – mis en avant dans l’édito de cet évènement le rôle central qu’a eu une femme, Hedy Lamarr, dans la conception des protocoles permettant de nos jours la communication sans fil.
Les femmes occupent en France seulement 24 % des emplois dans la tech. Et quand je regarde la salle aujourd’hui, nous n’atteignons pas ce chiffre. Au rythme actuel, la parité pourrait n’être atteinte qu’en 2070.
L’enjeu n’est pas de répondre à une cause féministe, l’enjeu est stratégique. Toutes les études convergent : les équipes mixtes innovent davantage, produisent des solutions plus robustes et connaissent des performances économiques supérieures. C’est donc un levier de compétitivité.
Nous devons chacun, à notre niveau, nous impliquer pour cette cause à laquelle je vous sais tous sensibles.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon trip à tous !"
Laure de La Raudière, présidente de l'Arcep