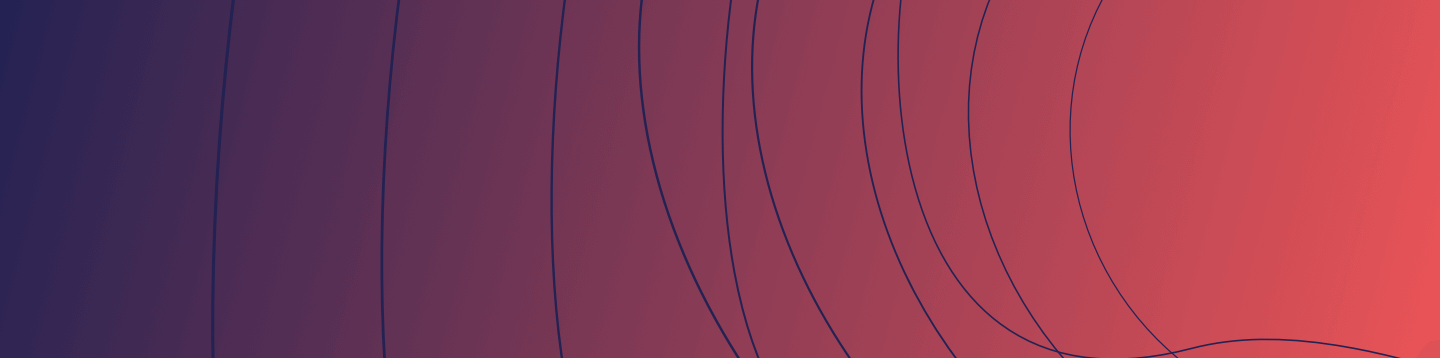Mesdames et Messieurs,
C'est à la fois un honneur et un réel privilège d'être ici aujourd'hui, devant un public aussi distingué d'experts juridiques. C'est impressionnant.
En tant que présidente de l'Autorité française de régulation des télécoms, je suis très fière de participer à cet échange, au croisement du droit de la concurrence et de l'économie numérique.
En préparant mon discours, j'ai regardé attentivement les thèmes de cette conférence : la concurrence entre services cloud , la mise en œuvre du Règlement sur les marchés numériques, la souveraineté et la sécurité numériques, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que le développement rapide de l'économie numérique n'aurait tout simplement pas été possible sans la couche fondamentale de l'infrastructure numérique : les réseaux. Et surtout, des réseaux de bonne qualité, pour tous et partout.
Alors que certains critiquent explicitement la régulation numérique, et la régulation dans son ensemble, en Europe et dans le monde, je pose la question suivante : compte tenu des défis auxquels nous sommes confrontés, que pouvons-nous attendre de la régulation ? Lorsque je parle de régulation, j'entends la régulation ex ante, comme dans le secteur des télécoms, qui peut être utilisé comme une bonne étude de cas. J'aimerais revenir sur un quart de siècle d'utilisation du numérique pour partager avec vous ce que la régulation peut accomplir. Prenons quelques instants pour remonter le temps avant d'aborder les défis actuels et futurs. Nous retournons seulement 25 ans en arrière et nous resterons en France. Mais les exemples que je vais prendre sont valables pour la plupart des pays occidentaux.
Nous sommes en 2000. L'internet est un luxe, et il s'agit essentiellement de connexion fixes par des modems bruyants... L’accès à internet en haut débit est un rêve, limité à une poignée de villes qui découvrent l'ADSL. Les téléphones mobiles ? Ils ne servent qu'à téléphoner, à peine trois heures par mois, et à envoyer une poignée de SMS. Les smartphones ? Encore de la science-fiction.
Un ménage type paie alors environ 75 euros par mois pour un mélange d'internet à bas débit, moins de cinq heures de téléphonie fixe. L'accès au numérique était inégal et coûteux, presque un privilège.
Ce qui s'est passé ensuite est simplement une révolution. Et la régulation a joué un rôle décisif en permettant cette transformation.
Nous pouvons diviser ce voyage en cinq chapitres, chacun marqué par des changements spectaculaires :
Premier chapitre : l'ère de la démocratisation entre 2000 et 2005
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est passé de près de zéro à 70 %. En 2004, plus de la moitié des ménages français possédaient un ordinateur. L'accès à l'internet fixe est passé de 6 % à 40 % en cinq ans seulement. Ces bonds ont été permis par l’ouverture à la concurrence et la montée en puissance de nouveaux entrants sur les marchés télécoms, grâce à un accès imposé par l’Arcep au réseau de l'opérateur historique.
Deuxième chapitre entre 2005 - 2010 : le boom des services
La généralisation de l'ADSL ouvre la voie à de nouveaux services numériques. Le streaming remplace progressivement le téléchargement. Des plateformes comme Deezer et Spotify émergent. Les réseaux sociaux prennent leur essor. En 2010, près de 80 % des adolescents français les utilisent. Le e-commerce explose. Derrière cette montée en puissance, la régulation a imposé des offres d'accès à haut débit, le dégroupage de la boucle locale à l'opérateur historique. Cette régulation a placé le consommateur au centre (baisse notable des prix de détail) et a favorisé l'investissement dans les secteurs.
Troisième chapitre entre 2010-2015 : l'ascension du smartphone et le premier développement de l’internet mobile
Le lancement de l'iPhone en 2007 marque une nouvelle ère. En cinq ans, le taux de possession de smartphones passe de 17 % à 58 %. L'utilisation des téléphones portables explose, stimulée par le déploiement de la 4G. Les utilisateurs naviguent sur l’internet mobile, à téléchargent des applications et à utilisent les messageries instantanées, le tout depuis le creux de leur main. À la maison, le haut débit est devenu la norme. Une fois de plus, la régulation a joué un rôle clé : enchères pour l’accès aux fréquences, obligations de couverture et garde-fous concurrentiels ont permis à l'écosystème de rester dynamique et ouvert à tous.
Quatrième chapitre entre 2015 et 2020 : L'ère des plateformes
Netflix est lancé en France en 2014. En 2019, un tiers de la population est abonné à la vidéo à la demande. Les réseaux sociaux poursuivent leur ascension et sont utilisés par 70 % de la population en 2020. Les réseaux de télécommunications, régulés pour favoriser leur ouverture et leur robustesse, constituent l'épine dorsale invisible mais essentielle de cette économie numérique de plateforme.
Cinquième chapitre entre 2020 et 2025 : Le numérique est partout et indispensable à tous
Fin 2024, la France compte plus de 32 millions d'abonnements à l'internet fixe. La fibre représente désormais 75% des connexions à haut et très haut débit. La consommation de données explose, avec plus de 200 Go par abonnement sur les réseaux fixes et 16 Go sur les réseaux mobiles. De nouveaux usages se développement très rapidement, comme le cloud et l'intelligence artificielle générative. Et tout cela est possible parce que les réseaux étaient prêts.
Ce parcours de vingt-cinq ans est une démonstration de ce qu'une régulation pro-innovation peut accomplir.
Mais nous n'avons pas encore terminé. Et ce que je m'apprête à décrire est certainement vrai au niveau européen également.
Les défis à relever sont réels. Sur les réseaux fixes, l’achèvement des déploiements de la fibre dans tous les territoires est une priorité. Dans le même temps, l'abandon du cuivre doit être géré avec soin, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte, en particulier dans les zones rurales. Enfin, nous devons garantir la viabilité économique à long terme des réseaux d'initiative publique, qui sont essentiels pour réduire la fracture numérique.
Pour y parvenir, la régulation complète son objectif d’ouverture du marché par du monitoring et une surveillance de la qualité à long terme.
Cela signifie tout d'abord qu'il faut veiller à ce que les déploiements en fibre optique soient totalement réalisés, en contrôlant rigoureusement les engagements des opérateurs.
Deuxièmement, cela signifie qu'il faut gérer de près l'arrêt du réseau cuivre. Cette fermeture relève principalement de la responsabilité de l'opérateur historique, mais nous suivons de près la situation et adaptons notre régulation autant que nécessaire. La fermeture doit être progressive et coordonnée. Là encore, la régulation joue un rôle essentiel dans l’animation concurrentielle et la protection des utilisateurs finals.
Troisièmement, nous devons nous concentrer sur la performance du réseau et la transparence associée. La disponibilité ne suffit plus, c'est la qualité de service qui compte. Pour cela, l'Arcep publie des cartes de couverture détaillées et un Observatoire de la qualité des réseaux en fibre optique. Ces outils permettent aux collectivités locales, aux opérateurs et aux utilisateurs de s'assurer que la promesse de la fibre optique se concrétise sur le terrain.
En bref : nous entrons dans une nouvelle phase de la régulation des télécoms. Une phase où l'objectif n'est pas seulement l'accès, mais une infrastructure numérique résiliente, de haute qualité et inclusive.
Et si nous voulons tirer parti de la réussite de ces 25 dernières années, nous devons rester aussi engagés, aussi vigilants et aussi ambitieux.
Jetons donc un coup d'œil sur les étapes à venir.
Il reste au moins trois défis majeurs à relever pour libérer le potentiel de la transformation numérique, pour lesquels la régulation a un rôle à jouer. En ce sens, nous considérons que les régulateurs traditionnels des télécommunications peuvent devenir des « régulateurs des infrastructures numériques ».
Premier défi : Régulation des plateformes
Au cours de la dernière décennie, il a été démontré que l'écosystème numérique est de plus en plus dominé par quelques grandes plateformes, ce qui a soulevé des inquiétudes légitimes quant à l'équité du marché et à la liberté de choix de l'utilisateur. La loi sur les marchés numériques représente une étape importante pour répondre à ces préoccupations en promouvant la concurrence et en empêchant les comportements de « gatekeeping ».
A l'Arcep, nous contribuons activement à la mise en œuvre du DMA, notamment à travers notre implication au sein du BEREC (l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques) et au sein du Groupe d'experts de haut niveau du DMA (Digital Markets Act).
Nous appelons la Commission européenne à rester ferme et à appliquer ce texte ambitieux avec détermination et agilité.
Deuxième défi : garantir des marchés concurrentiels et ouverts pour les services cloud
Le cloud est un autre pilier des services numériques modernes, et en particulier des services d'intelligence artificielle.
Pour les entreprises, il est essentiel de pouvoir choisir et changer de fournisseur de services cloud facilement. Actuellement, les pratiques de verrouillage des fournisseurs entravent cette flexibilité, étouffant l'innovation et la concurrence. Le règlement sur les données vise à résoudre ces problèmes en facilitant la portabilité des données et l'interopérabilité.
L'Arcep s'engage à améliorer la dynamique des services cloud en France. Nous avons lancé une consultation publique pour recueillir des informations sur la situation actuelle et nos travaux relatifs à l'interopérabilité des services de cloud seront publiées dans les prochains mois. Notre objectif est de contribuer à la création d'un écosystème de services cloud qui offre aux entreprises de véritables choix et favorise un marché concurrentiel.
Troisième défi : L'IA et l'économie fondée sur les données
Depuis plus de dix ans, on parle de l'économie de la donnée. Il me semble que ce concept est aujourd'hui dépassé.
L'utilisation des données est un carburant pour l'ensemble de notre économie. Je pense que nous pouvons donc désormais parler d'une économie par la donnée. Les services d'IA en sont l'exemple le plus évident, car ils ont le potentiel d'alimenter l'ensemble de l'économie.
Nous n'en sommes plus au stade où il faut convaincre les gens de la pertinence de l'accès aux données. L'histoire est passée par là, tout comme les règlements européens, en particulier le Data Act et le Data Governance Act. Le cadre est désormais en place.
Il est temps d'agir.
Dans ce contexte, nous avons, en tant que régulateurs, une grande responsabilité : celle de rendre les choses possibles et de soutenir l'émergence de nouveaux modèles. Aujourd'hui, les entreprises ont compris les opportunités commerciales qui peuvent être créées par leurs données ; elles ont également besoin d'accéder à certaines autres données pour améliorer leurs modèles d’affaires ou en créer de nouveaux.
Pour répondre à ces besoins : il s'agit de mettre en œuvre le cadre européen de partage et d'accès aux données pour les entreprises, c'est-à-dire essentiellement de mettre en œuvre les dispositions de ces deux textes.
À l'Arcep, nous nous y employons avec enthousiasme et détermination, en concertation avec les autres régulateurs français et européens. Je pense à la CNIL, bien sûr, mais aussi aux autres régulateurs européens des télécoms, ou encore aux différents acteurs réunis au sein du Comité pour l’innovation en matière de données.
Concrètement, l'Arcep a ouvert une plateforme permettant aux prestataires d'intermédiation de données de s'enregistrer en France, pour l'ensemble de l'Europe, et de demander une certification.
Le maître mot de notre démarche est l'esprit du Data Governance Act : établir la confiance entre les entreprises pour faciliter le partage des données. Cela stimulera le partage des données en France et en Europe, au bénéfice de l'économie.
Cela permettrait, par exemple, d'alimenter des modèles d'IA spécialisés. Les enjeux de l'IA mériteraient une conférence dédiée (comme celle que l'IBA a organisée en novembre dernier), mais les points que je viens d'évoquer sur l'ouverture et la dynamique concurrentielle du cloud et des services de données me semblent s'appliquer particulièrement bien aux services généralistes d'IA générative.
Conclusion
J'entends ici et là que la régulation est un obstacle à l'innovation. Mais au contraire : la régulation ex ante peut être un catalyseur de l'innovation. Voyez l'évolution des télécoms depuis 25 ans. La régulation permet d'ouvrir les marchés, de bousculer les gatekeepers et de lever les barrières, de garantir l'équité et d'élargir le champ des possibles. Elle permet à de nouveaux entrants de bousculer les positions établies. Dans le monde numérique, je dirais même qu'il n'y a pas d'innovation sans régulation... Des efforts de collaboration et une régulation ambitieuse seront essentiels pour construire des infrastructures numériques durables, résilientes et inclusives dont l’Europe a besoin. C'est au cœur de notre stratégie "Ambition 2030" : des infrastructures numériques partout, pour tous, et pour longtemps.
Nous entrons dans une nouvelle phase de la régulation des marchés numériques en Europe. Avec l'adoption d'instruments historiques tels que le Digital Markets Act, le Data Act, le Data Governance Act, un nouveau cadre est désormais en place. Il est ambitieux et il est là pour durer. Ce cadre devrait maintenant commencer à se stabiliser et à porter progressivement ses fruits.
Dans ce contexte, la communauté juridique aura un rôle crucial à jouer. Elle sera à l'avant-garde de cette dynamique, conseillant les entreprises, façonnant les interprétations et contribuant à garantir que les marchés numériques fonctionnent de manière équitable et efficace.
C'est pourquoi des forums comme cette conférence sont si précieux. Ils offrent un espace pour partager des points de vue, confronter des idées et contribuer collectivement au développement d'une culture juridique et réglementaire commune, essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur.
Je vous remercie de votre attention.
Laure de La Raudière, présidente de l'Arcep.