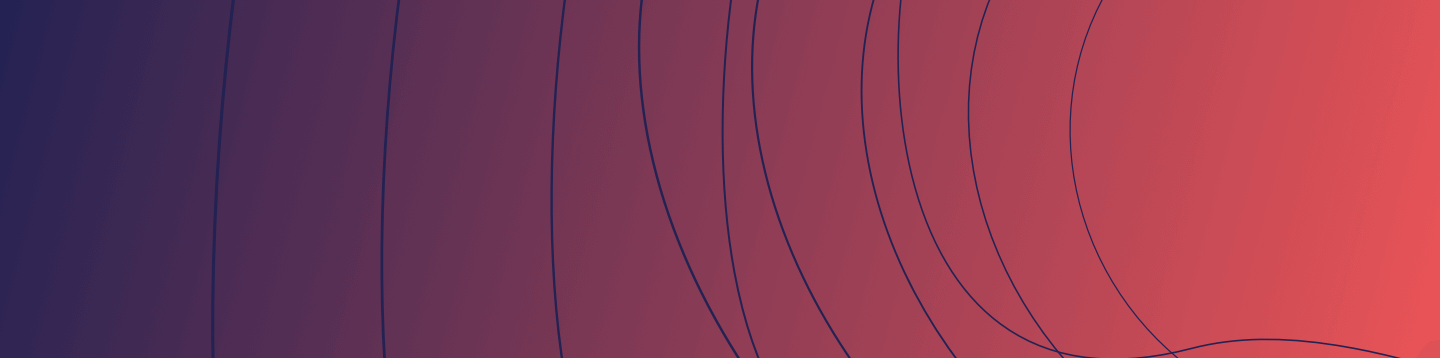Seul le prononcé fait foi
« Mesdames et messieurs,
Merci à Eurocloud pour l’organisation de la Cloudweek.
Merci aussi à Francis Weill ainsi que Loic Rivière pour leur invitation à intervenir en introduction de cette journée.
Félicitations pour le choix des panels de sujets à l’ordre du jour de vos échanges. Ils offrent un panorama des quatre principaux enjeux actuels du cloud : son adoption par les entreprises - moins rapide en France que dans d’autres pays, la souveraineté des infrastructures cloud, gage d’indépendance stratégique et de sécurité, le développement de l’intelligence artificielle et, bien sûr, la soutenabilité environnementale du numérique. Ces sujets rejoignent les priorités de l’Arcep et ses engagements sur les marchés numériques.
Premier enjeu : l’adoption des services cloud.
Comment dépasser le constat fait par la Commission européenne du retard pris en matière d’adoption du cloud par nos entreprises ?
Comment rassurer les entreprises du bien-fondé des services cloud pour garantir leur compétitivité à moyen et long terme, sans qu’elles aient l’impression d’une perte de maitrise de tout ou partie de leur autonomie stratégique ?
Finalement, comment opter pour le cloud lorsque la menace du verrouillage auprès d’un fournisseur plane sur les projets de migration des services vers le cloud ?
Une des réponses à cet enjeu, probablement pas la seule, mais elle est structurante, est de faciliter, par la régulation, la possibilité de changer de fournisseurs cloud ; de lever les barrières techniques et commerciales mises par les fournisseurs de services cloud au changement.
En mai 2024, la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique a confié à l’Arcep de nouvelles missions sur le cloud justement pour lever les barrières techniques et commerciales au changement de fournisseur.
Dès la promulgation de la loi, nous avons organisé des réunions d’échanges avec les fournisseurs de services cloud, avec leurs clients ou les représentants des entreprises et DSI, avec des entreprises de services numériques dans une démarche proactive d’écoute et d’accompagnement. C’est notre méthode classique de travail. Nous souhaitons que notre futur cadre de régulation ne soit pas déconnecté des enjeux techniques et économiques des entreprises. En un an, nous avons aussi mené deux consultations publiques, pour recueillir l’avis du secteur sur la compréhension des enjeux, et réagir sur nos propositions de régulation.
Concernant les barrières commerciales, nous avons la mission d’encadrer les frais de transfert de données lors d’un changement de fournisseur. Nous avons remis, comme le prévoit la loi, une proposition au gouvernement. Ces frais doivent être, selon nous, égaux à zéro, en dehors des prestations complémentaires ou de spécificités demandés par les clients, tout simplement parce que les fournisseurs ne font pas face à des coûts spécifiques liés à ce transfert de données lors du changement de fournisseur.
Concernant les barrières techniques, nous avons la mission de préciser les règles et modalités de mise en œuvre des exigences essentielles par les fournisseurs cloud relatives à la portabilité et de l’interopérabilité. Nous avons eu une approche pragmatique. Nous sommes en train d’analyser les réponses à la consultation publique sur ce sujet et comptons adopter très prochainement une recommandation qui vise à encourager la transparence et la mise en place de bonnes pratiques de documentation et de mise à jour des API.
À présent, la régulation du cloud se mettra en œuvre à l’échelle européenne et c’est une très bonne chose, car l’Europe est le niveau pertinent de régulation sur ce marché.
Le 12 septembre, la semaine dernière, le règlement sur les données, le Data Act, est entré en application. Il fixe un ensemble de règles que l’ensemble des fournisseurs de services cloud doivent respecter et qui s’appliqueront à tous les contrats : transparence, droit à la portabilité, et droit à l’interopérabilité.
Ces règles reposeront notamment sur des normes élaborées par l’écosystème via les organisations européennes de normalisation. J’en profite donc pour faire appel à vous, fournisseurs : participez à ces travaux, apportez votre expertise et faites valoir votre point de vue dans l’élaboration des futures normes européennes.
De notre côté, nous resterons mobilisés auprès de la Commission européenne et auprès du réseau des régulateurs européens, le Berec, afin que les travaux menés ensemble dans le cadre de la loi SREN soient utiles à tous, et pour que les dispositions du Data Act soient pleinement et uniformément appliquées, en France et dans l’ensemble des états membres.
Deuxième enjeu : la souveraineté.
J’ai la conviction qu’il ne peut y avoir de souveraineté sans un marché vraiment ouvert, pleinement concurrentiel, où les offres alternatives peuvent réellement émerger. J’ai aussi la conviction que la régulation européenne du numérique est le moyen d’atteindre cet objectif, pas le seul, mais c’est un préalable.
Comme je le disais, le Data Act pose des règles pour faciliter le changement de fournisseur cloud. Le Digital Market Act (DMA) de son côté impose des règles spécifiques à quelques grandes entreprises du numériques qui ont un pouvoir systémique, des contrôleurs d’accès, les Gatekeepers, pour des services essentiels désignés par la Commission européenne. Notre constat, suite aux échanges avec l’écosystème, et notamment les clients de grands fournisseurs de cloud, nous amènent à recommander à la Commission européenne de désigner, dans le cadre du DMA, les principaux fournisseurs de services cloud en tant que contrôleurs d’accèscloud, afin de compléter les outils du Data Act pour permettre un marché du cloud réellement ouvert.
Nos constats sont largement partagés. L’Autorité de la concurrence britannique, appelle aussi à désigner les hyperscalers comme disposant d’un « statut de marché stratégique », afin de pouvoir leur imposer des remèdes asymétriques. Les travaux de l’Autorité de la concurrence en France vont également dans ce sens.
Je le redis : pas d’autonomie stratégique européenne dans le numérique sans déverrouillage réel du marché des services cloud.
Je souhaite aussi sur ce sujet de souveraineté, mais je vais au-delà de mes missions à l’Arcep, je souhaite aussi qu’il y ait une réelle politique de préférence communautaire pour le secteur des services non marchands, non soumis aux contraintes de compétition internationale.
Cela permettrait aux acteurs européens d’avoir accès à un marché important, et ainsi se développer, d’innover et nous pourrions jouer avec des armes équitables par rapport aux entreprises américaines.
Troisième enjeu : l’intelligence artificielle.
Le rapport Draghi le souligne : l’Europe dispose d’un atout considérable pour le développement de modèles d’IA : des données de qualité. Mais pour valoriser ces données, encore faut-il pouvoir les partager dans un cadre de confiance. C’est l’ambition de la Commission européenne, avec la labellisation des intermédiaires de données dans le cadre du Data Governance Act ou les mesures du Data Act pour favoriser le développement d’espaces de données.
Mais, l’intelligence artificielle nécessite aussi de disposer d’une puissance de calcul considérable. Or, les hyperscalers concentrent une grande partie de la capacité de calcul européenne, et mondiale. Et leurs services numériques traditionnels (moteurs de recherche, plateformes vidéo, suites bureautiques…) pourraient constituer un risque majeur de verrouillage face au développement des agents d’IA. Face à ces risques, garantir que les marchés restent ouverts et concurrentiels est une condition pour permettre l’émergence d’acteurs européens innovants.
N’attendons pas que les pépites françaises et européennes soient mortes pour agir ! Ne laissons pas l’histoire se répéter. Là aussi, nous appelons la Commission européenne à agir grâce aux leviers dont elle dispose avec le Digital Market Act.
Enfin, quatrième et dernier enjeu : l’empreinte environnementale du numérique.
Il est aujourd’hui inconcevable de parler du développement de l’intelligence artificielle et du cloud sans tenir compte de leur impact environnemental.
Ce sont des centres de données qui hébergent nos données, nos services cloud, nos assistants d’IA : ils ne sont pas « immatériels ». D’après les prévisions du laboratoire de Berkeley, d’ici à 2028, plus de la moitié de l’électricité consommée par les centres de données sera utilisée pour l’IA. Et je veux aussi rappeler que nos travaux antérieurs au boom de l’IA estimaient déjà que l’empreinte carbone du numérique en France pouvait tripler entre 2020 et 2050…
L’explosion de la consommation d’électricité et d’eau du secteur, surtout à cause des grands modèles d’IA, donne lieu à un début de prise de conscience des impacts environnementaux de nos usages numériques.
Pour autant, il reste du chemin à parcourir pour mieux mesurer ces conséquences. Un exemple : Mistral, fournisseur d’IA français, évalue les émissions de gaz à effet de serre imputables à la génération d’une page de texte via leur modèle à 1 gramme d’équivalent CO2. Mais de son côté, Google évalue les émissions d’un prompt adressé à leur modèle à 0,03 gramme, soit 30 fois moins. Je m’interroge sur de tels différences. Et je souhaite que nous travaillions ensemble sur des méthodologies d’évaluation robustes et transparentes.
À l’Arcep, nous entendons contribuer à approfondir et partager la connaissance de l’impact de l’intelligence artificielle. C’est pourquoi, avec le pôle d’expertise de la régulation numérique au sein de l’État, le PEReN, nous menons en ce moment-même un projet visant à évaluer la consommation énergétique des grands modèles d’IA.
Et au-delà du sujet de l’IA, il convient d’agir pour réduire l’impact environnemental du numérique. C’est dans ce but que l’Arcep et l’Arcom, conjointement avec l’Ademe, et d’autres institutions publiques, ont publié l’année dernière le Référentiel Général de l’Ecoconception des Services Numériques (RGESN).
Des services éco-conçus, cela veut dire moins de nouveaux centres de données nécessaires, moins de nouveaux équipements réseaux, moins de changement de terminaux et donc moins d’impact sur l’ensemble des briques du numérique. Progressivement, ce doit être aussi un avantage compétitif pour nos services numériques : la concurrence par la sobriété. Nous avons récemment constitué un forum pour l’écoconception des services numériques, rassemblant développeurs, plateformes, hébergeurs, chercheurs…
Les objectifs sont clairs : partager les bonnes pratiques, encourager les démarches sobres et responsables, encourager la prise de conscience et faciliter le passage à l’échelle. Vous y êtes les bienvenus.
Nous sommes dans un moment politique, économique et industriel clé en matière de cloud, et en matière de numérique en général. Grâce aux écosystèmes économiques et industriels, à vous, grâce à la volonté politique, la France et l’Europe ont les clés pour bâtir les infrastructures numériques durables dont nos concitoyens et nos entreprises ont besoin. Vous pouvez aussi compter sur l’Arcep pour accompagner cette dynamique.
La CloudWeek est la preuve de la mobilisation de cet écosystème dans cette perspective. Votre conférence s’annonce donc passionnante dans ce contexte. Un grand merci à nouveau aux organisateurs. Je vous souhaite à tous une excellente CloudWeek. »
Laure de La Raudière, présidente de l'Arcep