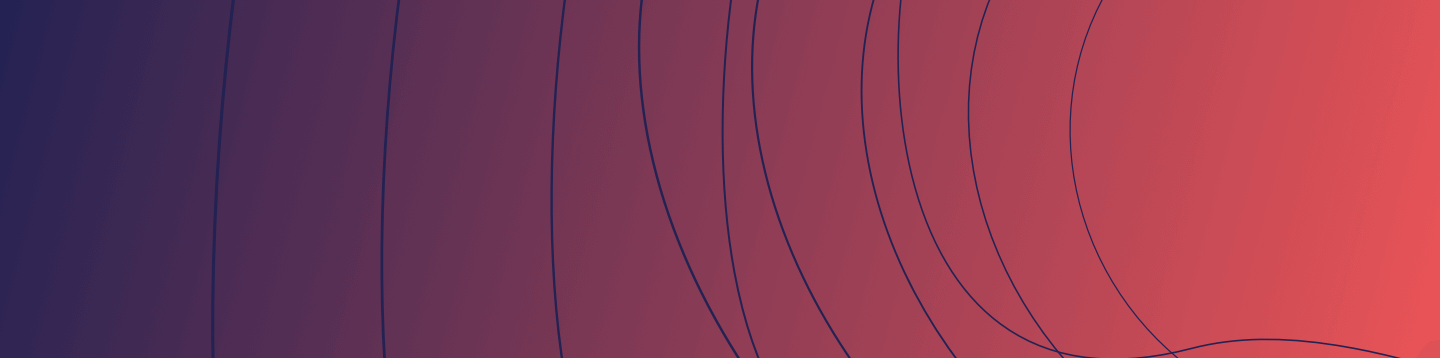"Monsieur le Ministre,
Monsieur le Sénateur, président de la commission supérieure du Numérique et des Postes,
Madame la Sénatrice,
Mesdames et Messieurs,
Merci de m’accueillir aujourd’hui à cette nouvelle édition des assises du Très Haut Débit. En préparant ces quelques mots, je me suis rappelé de nos débats il y a plus de quinze ans dans cette même enceinte. Il était presque exclusivement question de déploiement de réseaux fibre et de réseaux mobiles 4G. Puis au fil des années, sont apparues au sein de nos débats les enjeux de souveraineté numérique. En quelques années, les enjeux de connectivité ont trouvé des solutions dans des politiques publiques jugées efficaces par la Cour des Comptes, que ce soit en matière de déploiement de la fibre avec la plan France Très Haut Débit, ou grâce au New Deal Mobile qui a permis d’améliorer significativement la couverture Mobiles 4G dans les zones rurales.
Force est de constater que ce n’est pas encore le cas des enjeux de souveraineté numérique : nous sommes toujours très dépendants des pays étrangers pour les équipements et services du numérique devenus indispensables dans tous les instants de nos vies professionnelles et personnelles, et qui innervent nos économies et sociétés. C’est tout l’intérêt des débats qui vont avoir lieu ce matin, et je voulais vous féliciter d’avoir choisi ce thème « Souveraineté, sécurité et résilience : les nouveaux enjeux des infrastructures du numérique ». Ce thème est au cœur des préoccupations géopolitiques actuelles.
La crise du COVID, la guerre en Ukraine, et plus récemment l’élection de Donald Trump aux USA ont fait prendre conscience de la fragilité de notre économie et de notre société, en France, mais c’est plus nouveau au niveau européen. Souveraineté, résilience, indépendance stratégique sont maintenant à l’agenda de la nouvelle commission.
Et, en premier lieu sont concernées les infrastructures numériques, que ce soit les télécoms, les datacenters, les services cloud dont les services d’IA. Toutes ces infrastructures essentielles qui permettent à notre société de communiquer, d’échanger, de produire, de se sécuriser.
Alors que peut-on faire ? Que doit-on faire ? Quel peut être le rôle d’un régulateur comme l’Arcep ?
Mon premier message pour construire notre autonomie est qu’il faut créer un cadre de régulation favorable à l’émergence de nouveaux acteurs. Il ne peut y avoir d’autonomie stratégique sans alternatives crédibles aux géants mondiaux du cloud, les « hyperscalers ».
Dans le domaine des télécoms, c’est le cadre de régulation qui a favorisé l’émergence de nouveaux acteurs. Or, actuellement, on entend une petite musique, chantant les bénéfices supposés de la dérégulation, pour favoriser les investissements... Le marché des télécoms en France nous apporte la preuve parfaite du contraire : la régulation a apporté stabilité et prévisibilité, mutualisation et efficacité, innovation et compétitivité des prix. C’est ce cadre stable qui a justement favorisé les investissements par des fonds spécialisés. C’est ce cadre stable qui a permis de rendre raccordables à la fibre 92% des locaux en France aujourd’hui, presque tous éligibles aux offres de nos 4 opérateurs nationaux.
Nous plaidons donc pour la création de conditions claires et stables de régulation économique des services cloud et de l’IA, afin de favoriser l’investissement et le développement des acteurs émergents.
Trois actions nous paraissent importantes :
En premier : faciliter le changement de fournisseur. L’Arcep a été missionnée par la loi SREN en amont de l’entrée en vigueur du Data Act sur ce sujet. Nous avons initié depuis 2024 de nombreux travaux, en contact avec l’écosystème et nous venons de mettre en consultation publique ce que nous estimons être des bonnes pratiques, à mettre en œuvre par les acteurs pour faciliter le changement de fournisseurs cloud. Nous sommes très actifs auprès de la commission pour qu’elle reprenne nos travaux à l’échelle européenne, dès l’entrée en vigueur du Data Act.
En deuxième : désigner les géants du numérique comme des gatekeepers pour leurs services cloud, et certains services d’IA au titre du DMA, au niveau européen, sans quoi l’histoire va se répéter : de nouvelles barrières à l’entrée de petits acteurs innovants vont s’ériger. Par exemple, la capacité d’interaction des nouveaux modèles d’IA des hyperscalers avec leurs services numériques traditionnels (moteurs de recherche, services de cartographie, plateformes vidéo…) constitue un risque majeur de verrouillage de certains services. De même, l’accès aux ressources clefs pour le développement de l’IA que sont la puissance de calcul, l’énergie et les compétences devraient être facilité pour les acteurs émergents. C’est aussi une condition pour permettre notre souveraineté.
Et enfin, consolider un écosystème d’infrastructures de partage de données. Les entreprises ont besoin d’échanger un certain nombre de données, entre elles, dans un cadre de confiance. Avec la loi SREN, l’Arcep peut désormais labelliser des intermédiaires de données. Ce label, encore naissant, est valable dans toute l’Europe. C’est une première réponse. Ce peut être un nouveau front d’autonomie stratégique et un levier fort de souveraineté.
Mon deuxième message, pour construire notre autonomie, il faut le faire avec nos valeurs européennes et penser le temps long. C’est donc nécessairement penser à la soutenabilité environnementale de l’ensemble de notre écosystème numérique. Aujourd’hui, la consommation d’énergie du secteur explose, et les ressources en minerais et matériaux s’épuisent, et si rien n’est fait, l’empreinte carbone du numérique aura triplé d’ici 2050. Il ne s’agit plus seulement de concevoir des réseaux performants : c’est toute la chaîne du numérique, terminaux, datacenters, réseaux, services, qui doit intégrer les enjeux environnementaux, du design initial jusqu’à la fin de vie.
L’explosion des usages de l’Intelligence artificielle générative a enfin fait naître un début de prise de conscience que les services numériques, pourtant virtuels, immatériels, avaient eux aussi un impact sur toute la chaine du numérique. C’est une bonne chose, car pour bien adresser le sujet de l’empreinte environnementale du numérique, il faut prendre le problème à la source : c’est-à-dire s’occuper des services. Et aujourd’hui, c’est un angle mort des politiques publiques européennes.
L’année dernière, l’Arcep et l’Arcom, conjointement avec l’Ademe, et d’autres institutions publiques, ont publié le Référentiel général de l’écoconception des services numériques.
Si les services sont éco-conçus, cela veut dire moins de nouveaux datacenters nécessaires, moins de nouveaux équipements réseaux, moins de changement de terminaux et donc moins d’impacts sur l’ensemble des briques du numérique. Ce pourrait être aussi un avantage compétitif pour les services numériques. Nous avons récemment constitué un forum pour l’écoconception des services numériques, rassemblant développeurs, plateformes, hébergeurs, chercheurs… L’objectif est clair : partager les bonnes pratiques, encourager les démarches sobres et responsables, et faciliter le passage à l’échelle. Nous comptons sur une mobilisation de tous pour porter cette ambition au niveau européen.
Mon troisième message, pour construire notre autonomie, est bien connu de tous : il faut permettre aux acteurs émergents européens d’avoir un accès préférentiel aux marchés publics. Le climat géopolitique actuel nous donne un nouvel espoir pour une entente au niveau européen. Je ne le développerai pas, ce n’est pas du ressort de l‘Arcep, mais c’est une mesure essentielle pour notre autonomie stratégique et notre souveraineté.
Je vais conclure et je m’aperçois que je n’ai que peu évoqué les réseaux télécoms… J’ai préféré parler des marchés numériques et des missions récentes qui ont été confiées à l’Arcep.
Juste un mot pour vous dire que les réseaux sont bien sûr toujours au cœur de nos travaux et de notre stratégie. Notre nouvelle stratégie Ambition 2030 s’intitule d’ailleurs « des infrastructures numériques partout, pour tous, et pour longtemps. Le « pour longtemps » inclut les enjeux de soutenabilité, mais aussi la résilience et la pérennité financière de long terme des réseaux et leur résilience. Ce ne sont pas des options : c’est une nécessité, tant les réseaux sont devenus des fonctions vitales pour notre société. Le ministre l’a évoqué, je ne serai pas plus longue, je suis certaine aussi que mon collègue Zacharia Alahyane, membre du collège de l’Arcep, évoquera ces enjeux dans la première table-ronde pendant laquelle il intervient.
Merci à toutes et à tous."
Laure de La Raudière, présidente de l'Arcep.